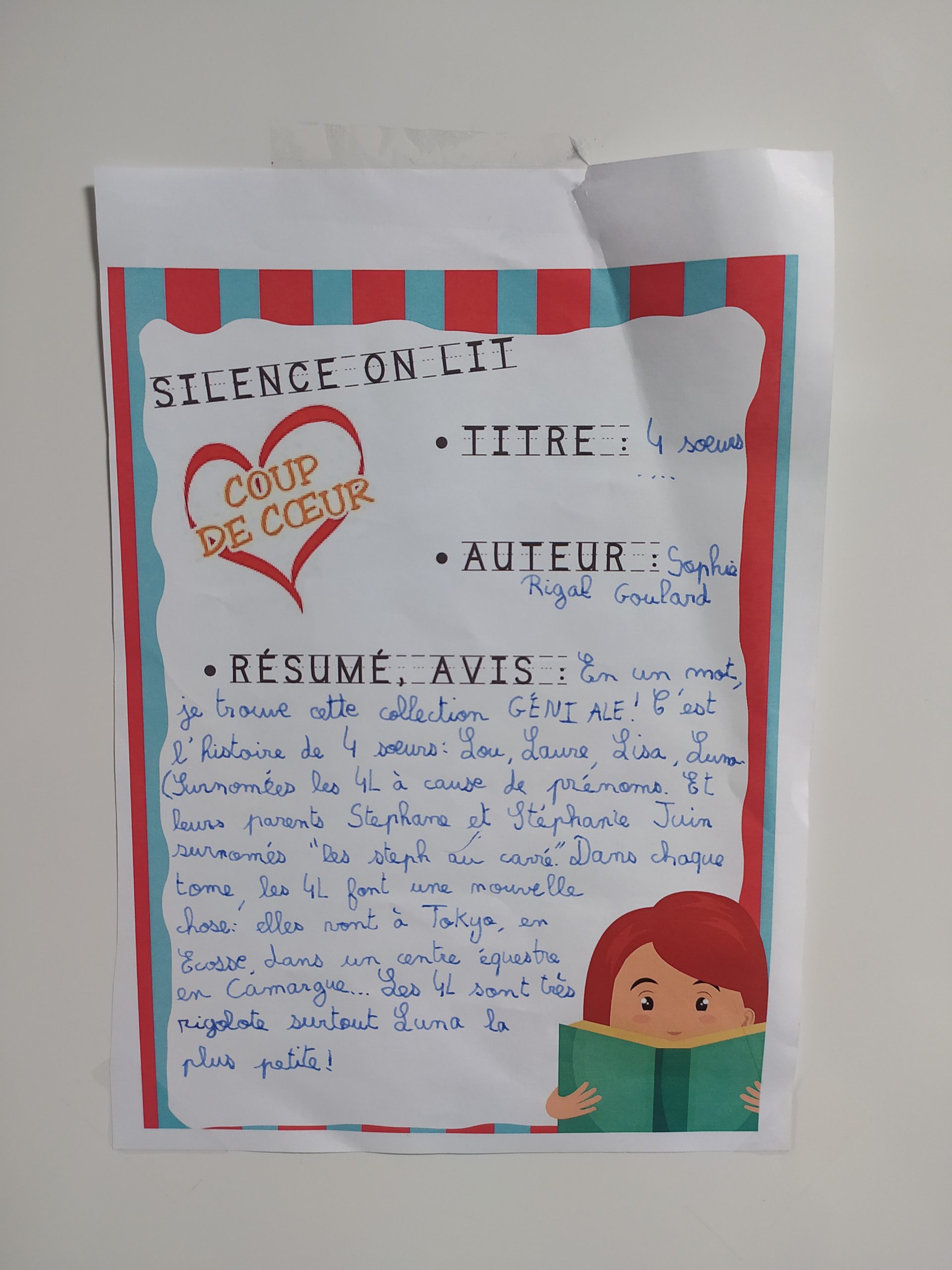Salut la Peupleraie !
Nous c’est la compagnie Hendrick Van Der Zee, ou plutôt HVDZ. Vous allez nous croiser dans les couloirs, dans la cour, dans les classes, à la cantine, à l’atelier au CDI.
Alexandre, Isabelle et Mourad sont arrivé.e.s aujourd’hui, le mercredi 22 mars, Zelda les rejoindra demain. Première journée de la première session au lycée professionnel de Sallaumines dans le Pas-de-Calais. On est presque à la maison, du moins à la maison d’HVDZ puisque la compagnie est basée à Loos-en-Gohelle. On voit même les terrils jumeaux par la fenêtre, ceux de la base 11/19. Si on zoomait un peu on pourrait voir le carreau de fosse, peut-être même la fenêtre des bureaux de la compagnie.
La Peupleraie c’est environ 400 élèves réparti.e.s entre CAP et baccalauréat professionnel en électricité, logistique ou commerce et vente. Des élèves qui viennent de Sallaumines, parfois de beaucoup plus loin pour la formation qu’iels ont choisi.
Ce projet à la Peupleraie n’est pas tout à fait comme les autres. Quand on fait un Instantané – c’est comme ça qu’on appelle les portraits que l’on fait des établissements scolaires – on reste cinq jours : trois jours d’immersion et de rencontres, un jour de répétition puis un de représentation. Ici, nous aurons plusieurs temps au lycée : d’aujourd’hui à lundi, puis trois jours en mai, et deux jours en juin pour les répétitions et le spectacle. Et on est bien content.es que ça commence !