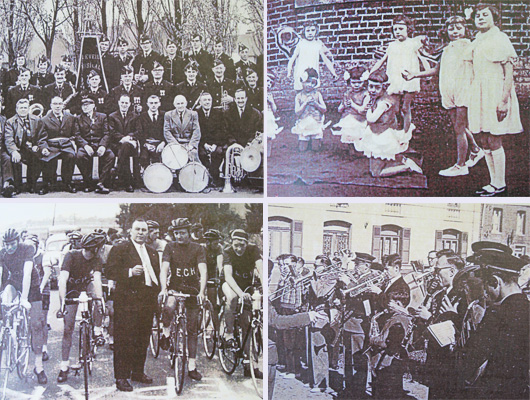Veillée # Hénin-Beaumont
entre ici et là-bas, y'a pas photo
A la Boule Beaumontoise, quand on est arrivé, ils jouaient encore mais tout de suite il y a eu une tempête, pluie et vent. On a tous couru dans le tout petit local algéco. Jérémie a fait des portraits. Guy et Flora des interviews. Beaucoup d’entre eux disent qu’ils rêvent d’un vrai local et d’un terrain couvert. La tempête. Un coca. Deux ou trois Perriers. Du bruit et de la chaleur humaine. Un des boulistes, qui est originaire de Perpignan dit « entre ici et là-bas dans le sud, y’a pas photo, c’est mieux ici. » et un autre dit « oh moi, si je pouvais aller dans le sud, je cracherai pas dessus… »
Autrefois à Beaumont
troisième journée dans l’après midi
On est retourné au club de boules de Beaumont sur le lieu de l’ancienne gare de Beaumont. Maurice, le doyen du club nous a longuement raconté l’histoire de la gare et de sa destruction. Maurice a passé sa vie aux chemins de fer. Il en est particulièrement fier. Fier du service public qu’on voudrait aujourd’hui démantelé. Il nous a raconté tous les chantiers auxquels il a participé. On a longuement parlé au coin du bar du local des boules. Il y avait beaucoup de monde aujourd’hui. On a fait des interviews et on a filmé les boulistes en action. On a parlé du club, de Beaumont, d’Hénin Beaumont et de la vie en général. On a parlé de la CCPM, la coopérative des mineurs dont l’entrepôt se trouvait juste à côté de l’ancienne gare de Beaumont.
sur le toit de l'église de Beaumont
les dames de Kennedy
Mmes Duhamel et Dubois sont arrivées autour des années 70. Voisins de palier. Elles se connaissent depuis toujours. Elles ont vécu toute l’évolution du quartier. Au début c’étaient les champs autour du quartier Kennedy. Elles ont changé trois fois d’adresse sans changer de maison. Aujourd’hui on a donné des noms de villes chiliennes aux rues du quartier. C’est une cité très solidaire les bruits colportés sur la cité sont faux. Il y a toujours quelqu’un sur un banc pour papoter. Elles vont très souvent à la maison de quartier. Pour rien au monde elles ne quitteraient le quartier Kennedy. Leurs enfants sont près d’elles. Au bout de la rue. Les gens ne quittent pas Kennedy. Les gens passent difficilement d’un quartier à un autre. Pourtant ce sont des petites cités. Ils ont tout sur place. Si il y a des gens qui déménagent, les gens reviennent à la maison de quartier Kennedy parce qu’il y a quelque chose de très fort qui se passe entre les gens du quartier.
Chaque jour à la ferme
Florian
Après notre repas à la cantine du personnel de l’hôpital, un café au Mundakafé, bonjour à Éric et Fanny. On s’est dit qu’on irait chaque jour. Un saut à la ferme pédagogique pour saluer Michèle et Stéphane qui accueillent encore un groupe aujourd’hui. Et voir Clopinette la chèvre, la mascotte.
Stéphane nous présente Florian. Il vient presque tous les jours. Il suit tout ce qui se passe à la ferme. Il est au courant de tout, connaît les animaux et se souvient de tous les évènements de la vie de la ferme. Aujourd’hui, l’événement c’est l’arrivée du taureau, pour les saillies.
prairie contre horizon
Entre la nostalgie et l’espoir d’un avenir plus équitable
On refait le monde. On a parlé, par exemple, d’Ikea. On en revient à la ferme pédagogique. Ce que l’on ne voit plus. L’origine des choses. Le début de la chaîne de production. Comment on fait les choses, et comment aujourd’hui on éloigne de nous la production. Porter les œillères sur l’origine des choses nous permet de consommer plus. Plus de produits, plus d’énergie, plus de richesses. Mais la planète n’est que ce qu’elle est et si la finance multiplie les petits pains et les marges aux actionnaires, les richesses de la terre et la force de travail de l’humanité ne sont pas aussi exponentielles qu’ils le voudraient. Esclavage et culpabilité.
On consomme beaucoup et de moins en moins cher. Ikea, C&A et autres H&M. Quel est le prix a payer pour que les pauvres de l’hémisphère nord puissent se donner l’illusion d’être riches ? Trouver plus pauvre, par exemple dans l’hémisphère sud ? On se souvient d’une enquête du journal Libération qui parlait des rabatteurs des grandes usines textiles. Des rabatteurs qui allaient dans les campagnes pauvres de l’Inde pour proposer aux jeunes filles trois ans de travail contre une dot. Trois ans dans les usines du Tamil Nadu, enfermée, avec des horaires et des conditions de travail inhumains. Trois ans d’esclavage contre l’illusion de pouvoir faire un bon mariage, devenir consommateur à son tour. Pensée aussi pour le travail de l’artiste Ursula Biemann sur la frontière américano-mexicaine, Ciudad Juarez, où des milliers de femmes viennent travailler dans les usines d’assemblage électronique. Les Maquilladoras. Au risque de n’être que les engrenages d’une chaîne d’assemblage. Il n’y a qu’un pas qui a été si vite franchi vers la femme objet, exploitation sexuelle, prostitution, assassinats.
On a entendu parler d’un travail de recherche qui avait établi une sorte d’indice « équivalent esclave », c’est à dire que les richesses que l’on consomme sont traduites en force de travail. Un européen moyen aujourd’hui, consommerait plus d’« équivalents esclave » que Louis quatorze lui-même. Le monde capitaliste est conçu de telle sorte que notre frustration grandisse autant que notre richesse et que notre indifférence à l’exploitation dont nous sommes responsables.
On a parlé d’autarcie. De nécessité de réapprendre l’origine des choses. Faire. Aller rencontrer le début de la chaîne. Se poser la question de nos besoins, des conséquences de notre incapacité à affronter nos frustrations de pauvres.
Ici, à Henin-Beaumont, on a entendu parler de made in china plus d’une fois.
L’image serait au fond de la prairie où la jument, les chèvres et les moutons de la ferme pédagogique broutent, derrière le potager, l’enseigne Ikea, immense. La ferme pédagogique comme un bastion de résistance ? Ou comme le musée d’un temps révolu ? Entre la nostalgie et l’espoir d’un avenir plus équitable, plus partageur.